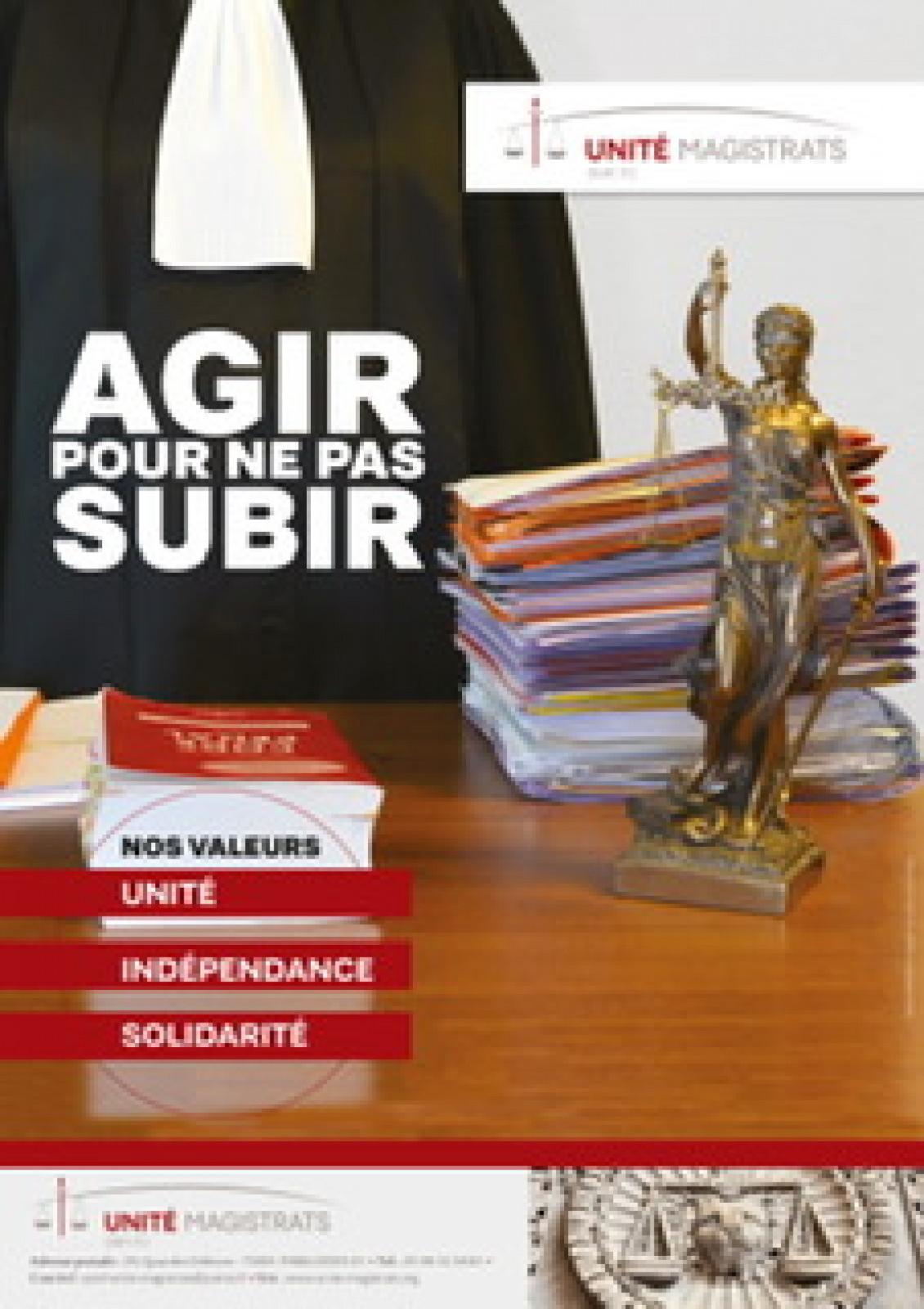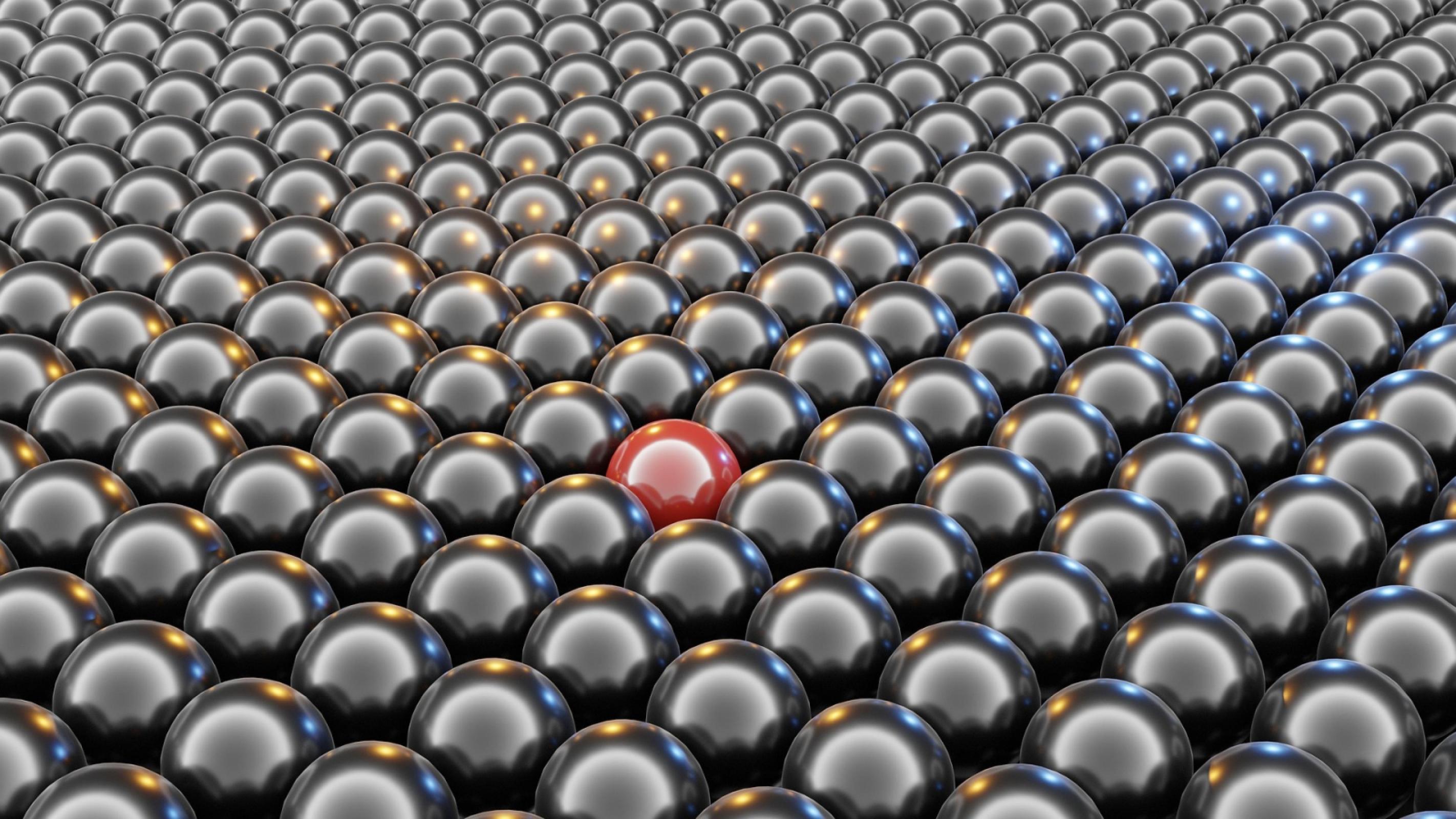PPL « DROIT A L’AIDE A MOURIR » : POURQUOI CETTE PROPOSITION MENACE NOS PRINCIPES ESSENTIELS.
UNITE MAGISTRATS a été entendu le 11 septembre 2025 par la Commission des Lois du Sénat sur la Proposition de loi n°661 relative au « droit à l’aide à mourir ».
Notre syndicat, qui porte et prône des valeurs humanistes, considère que la protection des plus faibles fait partie des missions les plus nobles du magistrat. Cette protection constitue également un pilier fondamental de toute société civilisée, basée sur les principes de solidarité et de fraternité.
A la lecture de cette PPL, on peut légitimement s’interroger sur les intentions du législateur de faire prévaloir le droit à la mort sur le droit à la vie et de ne pas mettre en place des mécanismes de protection et de recours légitimes contre tout abus. Notre syndicat a exprimé devant le Sénat son refus d’une instrumentalisation de la justice pour donner quitus à ces dispositions qui contreviennent à ses missions de protection.
De plus, seul notre Syndicat a exprimé de sérieuses réserves sur l’ensemble du texte, à l’instar de nombreux autres professionnels du monde médical, juridique et associatif, au regard de l’impact considérable qu’il aurait sur les fondements mêmes de nos grands principes juridiques.
Une PPL loin de faire l’unanimité.
En effet, cette PPL soulève de nombreuses difficultés, relevées par le Comité des droits des personnes handicapées (CPDH) de l’ONU, par des professeurs d’université, des juristes, des médecins, des bénévoles en soins palliatifs, des patients, notamment handicapés et leurs familles.
Le Comité des Droits des Personnes Handicapées (CDPH) de l’ONU a dénoncé par un récent courrier adressé à la France, un texte ne protégeant pas les personnes handicapées, employant des termes flous, et a préconisé des modifications.
L’Académie nationale de médecine, quant à elle s’est clairement positionnée contre l’euthanasie dans son avis du 6 mai 2025.
Le Conseil d’Etat, dans un avis du 4 avril 2024, rappelait : « Appréhender les situations de fin de vie à travers le seul instrument juridique risque de paralyser le jugement éthique qui, bien souvent, suffit pour qu’une décision juste soit prise » (…) « En la matière, encore plus que dans d’autres, le Conseil d’Etat ne peut que faire sienne la mise en garde du doyen Carbonnier : "Ne légiférer qu'en tremblant, préférer toujours la solution qui exige moins de droit et laisse le plus aux mœurs et à la morale" ».
A la lecture de cet avis une question émerge : cette nouvelle loi, sur un sujet si grave, est-elle vraiment nécessaire ?
Une nouvelle loi « fin de vie » nécessaire ?
Le droit positif, résultant de la loi du 2 février 2016 « Claeys-Leonetti » pose le principe selon lequel « Toute personne a le droit d’avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance » et offre à toute personne en fin de vie le droit de refuser un acharnement thérapeutique, de demander une sédation profonde et continue sous certaines conditions (notamment un pronostic vital engagé à court terme), pour soulager une souffrance réfractaire, pouvant conduire à abréger un processus de mort naturelle. La mise en œuvre de ce texte n’a quasiment pas généré de contentieux compte tenu de la clarté des termes employés et de l’équilibre trouvé.
Le Conseil d’Etat constate que cette loi « Claeys-Leonetti » a permis « de répondre à l’essentiel des demandes sociales relatives à la fin de vie » tout en convenant qu’elle ne permettait pas de prendre en compte les demandes d’aide à mourir émanant de patients qui ne sont pas en fin de vie.
Or, l’enjeu est de savoir si une personne qui peut déjà décider librement de se suicider, doit pouvoir bénéficier par la loi d’une aide active par des tiers ?
Une rupture anthropologique et juridique majeure ?
La PPL ouvre dans son article 4, la possibilité à des personnes souffrantes, « atteintes d’une affection grave et incurable qui engage le pronostic vital, en phase avancée, caractérisée par l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie, ou en phase terminale » de solliciter une aide à mourir, soit par suicide assisté soit par euthanasie.
Or, la définition de la « phase avancée » reste trop floue et susceptible de générer des interprétations aléatoires et du contentieux.
De plus, contrairement à ce qui était présenté dans les débats, cette nouvelle proposition de loi n’a pas tant pour objet d’aider les personnes en fin de vie à mourir, qu’à consacrer un nouveau droit à choisir le moment de sa mort.
Il s’agit d’inscrire la fin de vie dans un horizon qui n’est plus celui de la mort imminente ou prochaine, et d’autoriser un acte ayant pour intention de donner la mort, en opposition avec le principe fondateur universel « Tu ne tueras pas », repris en termes juridiques et sanctionné à l’article 221-1 du Code Pénal.
Cet interdit trouve également sa traduction médicale dans le Code de la Santé Publique à l’article R. 4127-38 CSP: « Le médecin doit accompagner le mourant jusqu’à ses derniers moments, assurer par des soins et mesures appropriés la qualité d’une vie qui prend fin, sauvegarder la dignité du malade et réconforter son entourage. Il n’a pas le droit de provoquer délibérément la mort ».
La PPL prévoit à titre principal que le patient s’administre lui-même la substance létale (suicide assisté) et à titre exceptionnel, s’il n’est pas en mesure physiquement de le faire, qu’une tierce personne le fasse à sa place (euthanasie).
Or, dans les pays où ces deux possibilités ont été ouvertes, c’est très majoritairement l’euthanasie qui est utilisé.
Le législateur a par ailleurs voté une clause de conscience pour les médecins et soignants, à l’exclusion de tout autre professionnel impliqué, y compris les pharmaciens.
En créant un « droit à » l’aide à mourir, et non pas une possibilité qui devrait rester exceptionnelle, le législateur va encore plus loin.
« Droit à l’aide à mourir » nouvel indicateur de performance de la santé publique ?
Un « droit à » est associé à une avancée qui doit profiter à tous. Dès lors, devrait-on se féliciter du nombre d’aides à mourir qui seront effectivement mises en œuvre, au point de devenir un indicateur de performance, et de créer un conflit de normes ?
La Convention Européenne des droits de l’homme, dans son article 2, garantit en effet un droit à la vie, pas un droit à la mort. « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement. » Ce principe est tellement fondamental que les Etats membres de la Convention ont ratifié massivement le protocole 13 interdisant la peine de mort.
Pour proposer une solution à ce conflit de normes, la CEDH s’appuie non pas sur le fondement du droit à la vie de l’article 2 mais sur l’article 8 (droit au respect à la vie privée) pour autoriser les Etats à légiférer sur l’euthanasie tout en indiquant qu’elle doit être strictement encadrée par la loi, pour éviter des dérives.
L’instauration d’un « droit à » ne pourra qu’entraîner l’élargissement à toute personne se prévalant d’une souffrance et revendiquant ce droit, comme l’illustre le droit comparé : l’euthanasie initialement « strictement encadrée », s’est élargie aux :
• mineurs en Belgique en 2014,
• enfants de 0 à 12 ans aux Pays-Bas en 2023,
• malades mentaux au Canada (prévu à terme en 2027).
• personnes qui ne sont pas en fin de vie : 21% des euthanasies en Belgique.
• « fatigués de la vie » : 27% des euthanasies en Belgique.
Un ancien député Jean-Louis Touraine, membre d’honneur de l’Association pour le droit à mourir dans la dignité (ADMD) affirmait en 2024 que la loi française ne serait que la première étape d’un système qui veut « mettre le pied dans la porte » et qu’il faudrait « revenir tous les ans » pour étendre l’aide à mourir aux catégories de personnes suivantes : « les mineurs, les maladies d’Alzheimer et les maladies psychiatriques », au nom de l’égalité. (voir les 5 dernières minutes de la vidéo)
Une procédure expéditive : 17 jours pour décider de la mort et seulement 2 jours pour statuer en cas de contestation pour un majeur protégé.
La procédure prévue par la PPL n’est pas du tout protectrice pour les personnes vulnérables, notamment dans le recueil et la qualité de leur consentement.
Le caractère expéditif de la procédure (2 jours minimum de délai de réflexion pour la personne demandeuse, 15 jours maximum pour que le médecin statue), doublé d’une absence de protection effective, ne correspond pas non plus aux délais plus longs prévus dans les autres pays qui autorisent l’euthanasie ou le suicide assisté. L’absence de consultation obligatoire d’un psychiatre ou d’un psychologue ou encore celle de la personne de confiance désignée par le patient, constituent des carences grave de la PPL, pour s’assurer d’un consentement libre et éclairé.
De plus, en cas de recours par le médecin ou le mandataire judiciaire ayant un doute sur l’aptitude et le discernement d’un majeur protégé à demander sa propre mort, le mandataire n’aurait que deux jours pour saisir le juge des contentieux et de la protection qui lui-même n’aurait que deux jours pour statuer.
Le JCP : un juge instrumentalisé pour décider de la mort d’un majeur protégé ?
Notre syndicat s’oppose fermement à ce qu’un juge, le JCP, dont le cœur de mission est de garantir une protection à des personnes vulnérables, soit instrumentalisé pour donner dans l’urgence un « blanc-seing » à une décision de faire mourir. Le délai ultra-court de 2 jours pour statuer, imposé au juge, est de plus irréaliste. Il obligerait celui-ci à potentiellement autoriser l’aide à mourir d’un majeur protégé sans pouvoir ordonner la moindre mesure d’instruction (audition de proches, nouvelle expertise psychiatrique…).
Quelle serait la responsabilité du mandataire et du magistrat en cas de dépassement du délai de 2 jours ou d’une mauvaise décision prise dans l’urgence et sans éléments suffisants ?
En tout état de cause, en cas de signalement par une tierce personne qui dénoncerait une infraction (homicide, abus de faiblesse notamment), la célérité de cette procédure ne permettrait pas à la justice de la suspendre en temps utile.
Recours pénal possible mais pour un patient déjà mort…
La PPL prévoit à son article 12, que le recours administratif contre les décisions du médecin relative à la demande d’aide à mourir, ne peut émaner que du patient lui-même, à l’exclusion de tiers. Le Conseil d’Etat rappelle cependant qu’il existera toujours la possibilité pour les proches du patient ou toute personne intéressée, de saisir la justice pénale en cas de soupçon de crime ou délit à l’encontre d’un patient euthanasié, soit des homicides volontaires ou involontaires ou encore des abus de faiblesse.
Si la justice pénale est saisie alors que la procédure d’aide à mourir a commencé, le Conseil d’Etat indique qu’il faut alors « suspendre » la procédure, mais sans préciser qui doit et peut ordonner cette suspension, ni jusqu’à quand et selon quelles modalités ? Et si la procédure d’aide à mourir est allée jusqu’au bout, quel est l’intérêt de déclencher a postériori une procédure pénale pour le principal intéressé ?
Compte tenu de ce risque pénal, réel, notre Syndicat propose de prévoir une information préalable du Procureur du parquet civil pour lui permettre de suspendre la procédure d’aide à mourir en cas de soupçons plausibles quant à la régularité et au bien-fondé de celle-ci ou quand il existe un soupçon sur la commission d’un crime ou d’un délit.
Cette proposition va dans le sens de la récente jurisprudence de la CEDH qui exige « que le suicide assisté, dès lors qu’il est admis, soit strictement et précisément encadré par la loi. Les autorités doivent définir avec clarté l'ampleur de ce droit ».
Notre Syndicat est le seul à pointer un risque majeur pour les personnes particulièrement vulnérables
En effet, plusieurs catégories de personnes fragiles sont exposées avec cette PPL :
-Les majeurs protégés, pour lequel il existe par hypothèse un doute sur les facultés de discernement, mais pour lequel le médecin ou le mandataire « peut » et non pas « doit » exercer un recours, sans aucune obligation de demander son avis à un psychiatre, et en laissant un délai extrêmement court au juge pour statuer.
-Les personnes handicapées.
Le Collectif Handicaps, auditionné par l’Assemblée nationale, a émis de fortes réserves sur le texte. Le CDPH de l’ONU a exprimé ses vives inquiétudes pour les personnes handicapées, allant jusqu’à parler de « risque de dériver vers une nouvelle forme d’eugénisme ». De fait, dans les pays où l’euthanasie est autorisée, les personnes handicapées sont sur-représentées dans les demandes d’aide à mourir.
-Les personnes privées de liberté : prison, EPHAD, hospitalisés sans consentement
La PPL prévoit que l’euthanasie est réalisable en dehors du domicile et dans certains lieux où les patients sont exposés à une particulière vulnérabilité, notamment dans les établissements de santé, les EPHAD, mais aussi les prisons.
Alors qu’un rapport parlementaire de juillet 2025 alerte sur la santé mentale dans les prisons françaises, d’autres études pointent l’augmentation des personnes atteintes de troubles psychiatriques. De tragiques affaires ont de plus montré que de nombreuses personnes âgées en EPHAD pouvaient être particulièrement isolées et maltraitées, et les patients hospitalisés sous contrainte méritent une attention particulière. Face à ces situations de vulnérabilité qui explosent, l’offre de soins reste totalement inadaptée. Qui pourra garantir alors avec la nouvelle PPL que ces personnes ne subissent ni pression, ni abandon pour en arriver à demander une aide à mourir ?
-Les personnes dépressives, isolées, en situation précaire.
L’étude du droit comparé permet de constater une prévalence de personnes en situation de vulnérabilité, liée à l’isolement social, à des problèmes financiers ou à la précarité, dans les demandeurs de suicide assisté ou d’euthanasie. Les aides à mourir demandées par des personnes dépressives constituent un problème médical, éthique et juridique majeur. Elles inquiètent fortement les psychiatres et interroge sur la compatibilité de ces dispositions avec la prévention du suicide.
La création d’un délit d’entrave sans équivalent dans le monde
Un délit d’entrave à l’euthanasie, puni de deux ans de prison et de 30 000 € d’amende, frapperait la personne coupable d’allégations ou d’indications « de nature à induire en erreur une personne sur les caractéristiques ou les conséquences de l’aide à mourir ». Le risque pénal, doublé de cette formulation floue, pourrait fragiliser l’action des soignants, des proches et des aidants auprès des plus vulnérables, particulièrement ceux qui travaillent à la prévention du suicide. Aucun des autres pays qui a légalisé l’euthanasie, n’a prévu un tel délit.
L’accompagnement des personnes qui sont en fin de vie auquel nous sommes attachés ne saurait être confondu avec un nouveau paradigme promouvant de nouveaux principes juridiques non protecteurs pour les plus faibles et mettant en cause la responsabilité des acteurs appelés à se prononcer sur des enjeux vitaux, dans des conditions juridiques floues et insécures, par des procédures d’urgence qui ne respectent pas la dignité humaine.
Notre Syndicat défendra toujours la haute mission du juge dans ses fonctions de protection des plus faibles.